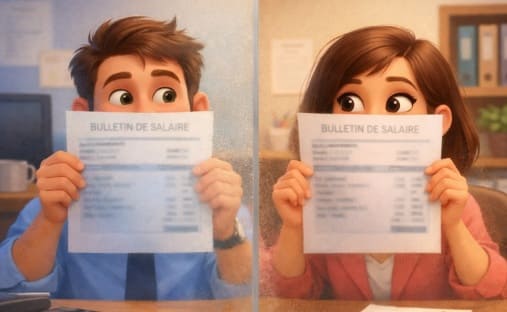
La transparence salariale va devenir une obligation structurante pour les entreprises françaises à l’horizon 2026, mais son calendrier exact reste sous tension entre exigence européenne et risques de retard côté employeurs.
Rappel du projet de transparence salariale
La directive européenne 2023/970 impose aux États membres de renforcer la transparence des rémunérations afin de réduire les inégalités salariales, en particulier entre les femmes et les hommes.
Elle prévoit notamment la publication d’écarts de rémunération, l’accès facilité à l’information pour les salarié·es et des actions correctrices obligatoires en cas d’écarts injustifiés.
Concrètement, les entreprises devront communiquer des informations précises dès l’embauche (fourchettes de salaires, critères d’évolution) et tout au long de la relation de travail.
Les obligations s’appliqueront plus fortement aux structures d’au moins 100 salariés, avec des dispositifs de reporting externes sur les écarts de rémunération.
Obligations clés pour les entreprises
Plusieurs volets sont en préparation dans le droit français pour se conformer à la directive.
Les principales obligations attendues sont :
-
Interdiction de demander l’historique de rémunération des candidats lors du recrutement.
-
Obligation d’indiquer une fourchette de salaire dans les offres d’emploi, y compris pour les PME.
-
Mise à disposition de critères objectifs et accessibles de fixation et d’évolution des rémunérations.
-
Reporting régulier sur les écarts de rémunération, avec un accent particulier sur l’égalité femmes-hommes et la notion de travail de valeur égale.
-
Publication de rapports externes pour les entreprises d’au moins 100 salariés, avec une fréquence annuelle au‑delà de 250 salarié·es et triennale sous ce seuil.
Calendrier officiel et marges de manœuvre
La directive doit être transposée en droit français au plus tard le 7 juin 2026, date butoir fixée pour l’ensemble des États membres.
Un projet de loi de transposition a été annoncé pour l’automne 2025, avec un objectif d’adoption avant la fin de l’année 2025.
Dans la pratique, les premières obligations de publication porteront sur les données de l’année 2026, avec un reporting attendu au plus tard en mars 2027 pour de nombreuses entreprises.
Autrement dit, même si la loi entre en vigueur mi‑2026, les entreprises devront être en mesure de tracer et documenter leurs pratiques de rémunération dès le 1er janvier 2026.
Un possible report… surtout côté mise en conformité
Plusieurs enquêtes montrent qu’une très large majorité d’entreprises françaises ne seront pas prêtes techniquement et organisationnellement pour juin 2026.
Plus de 9 entreprises sur 10 déclarent ne pas disposer d’un dispositif complet de transparence salariale à cette échéance, et un tiers anticipe une conformité réelle plutôt fin 2026, voire 2027.
Les discussions parlent donc moins d’un report politique de la directive, qui reste fixée à juin 2026, que d’une mise en œuvre progressive avec tolérance et phasage dans les contrôles.
Certaines analyses évoquent la possibilité d’un étalement des obligations selon la taille des entreprises, avec une montée en charge étendue jusqu’en 2027.


