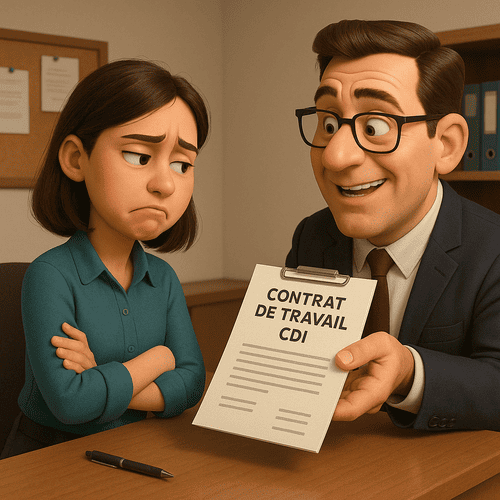Le salaire de référence constitue l’élément central du calcul de l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE). Sa détermination repose sur des règles précises définies par la réglementation de l’assurance chômage et nécessite une déclaration rigoureuse en Déclaration Sociale Nominative (DSN), notamment à travers les blocs 51 et 52.
Le salaire de référence : définition et principes fondamentaux
Qu’est-ce que le salaire de référence ?
Le salaire de référence pour le calcul de l’ARE correspond au total des rémunérations brutes perçues durant la période de référence calcul (PRC). Cette période s’étend sur les 24 derniers mois civils précédant la fin du dernier contrat de travail pour les demandeurs d’emploi de moins de 55 ans, et sur 36 mois pour ceux de 55 ans et plus (évolution depuis le 1er avril 2025).
Les cinq conditions pour l’inclusion dans le salaire de référence
Pour être prises en compte dans le calcul du salaire de référence, les rémunérations doivent répondre aux cinq conditions suivantes :
-
Elles entrent dans l’assiette des contributions d’assurance chômage
-
Elles n’ont pas déjà servi pour une précédente ouverture de droits
-
Elles se rapportent à la période de référence calcul
-
Elles trouvent leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail
-
Elles correspondent à la rémunération habituelle du salarié
Éléments inclus dans le salaire de référence
Rémunérations prises en compte
Le salaire de référence comprend l’ensemble des salaires et primes déclarés par l’employeur
-
Les salaires de base
-
Les primes normales ou exceptionnelles versées en contrepartie du travail
-
Les avantages en nature
-
Les gratifications et indemnités liées à l’activité
-
Les primes de treizième mois, de bilan, de vacances
-
Les heures supplémentaires et complémentaires
Primes mensuelles : déclaration en bloc 51
Les primes versées mensuellement qui compensent une contrainte liée à l’emploi sont intégralement prises en compte dans le calcul de l’ARE. Ces primes sont déclarées uniquement dans le bloc 51 avec le type 002 « Salaire brut servant aux calculs des droits de l’Assurance chômage ».
Il s’agit notamment des primes suivantes :
-
Prime de pénibilité, de risque, de cadence, de danger
-
Prime d’ancienneté
-
Prime d’habillage
-
Prime de présentéisme versée mensuellement
Primes périodiques : déclaration en bloc 52
Les primes non mensuelles nécessitent une déclaration séparée en bloc 52 « Prime, gratification et indemnité » lorsqu’elles répondent à au moins un des quatre critères suivants :
-
La nature de la prime correspond à l’un des codes prévus pour la rubrique 52.001 « Type »
-
La prime couvre une période différente de celle du salaire de base (ex. : 13ème mois pour l’exercice civil) ou ne correspond à aucune période d’activité précise
-
La prime ne rémunère pas l’activité (ex. : prime de naissance, de mobilité)
-
La prime est versée uniquement lors de la rupture du contrat de travail
Traitement spécifique des primes selon leur périodicité
Primes prises en compte au prorata temporis
Seule la part des primes supra mensuelles se rapportant à la période de référence est prise en compte pour le calcul de l’ARE. Sont concernées :
Prime exceptionnelle liée à l’activité (code 026) : Prime de productivité, de performance, liée à la surcharge d’activité, avec une période de rattachement correspondant au mois civil de versement.
Prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique (code 027) : Prime de 13ème mois, de Noël, de bilan, sur objectifs, de résultats, de vacances. La période de rattachement correspond à la période d’acquisition de la prime telle que prévue par l’accord collectif.
Prime de rachat de jours de RTT (code 029) : La période de rattachement correspond à la période d’acquisition des RTT.
Exemple pratique de déclaration
Pour des commissions versées en mai au titre du 1er trimestre 2025 :
-
Rubrique 52.003 « Date de début de la période de rattachement » : 01012025
-
Rubrique 52.004 « Date de fin de la période de rattachement » : 31032025
Éléments exclus du calcul de l’ARE
Indemnités de rupture
Toutes les indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont exclues du salaire de référence :
-
Indemnités de licenciement
-
Indemnités de rupture conventionnelle
-
Indemnités compensatrices de congés payés (ICCP)
-
Indemnités compensatrices de préavis
-
Indemnités transactionnelles
-
Indemnités de non-concurrence
Primes non liées à l’activité
Les primes déclarées avec le code 028 sont totalement exclues du calcul de l’allocation chômage car elles ne rémunèrent pas l’activité du salarié :
-
Prime de mariage, de naissance
-
Prime de déménagement
-
Primes et versements du CSE
Prime de partage de valeur (PPV)
La PPV est également exclue du calcul de l’ARE, étant déclarée avec les codes 904, 905 ou 906 selon le cas.
Impact sur les différés d’indemnisation
Calcul des différés spécifiques
Les indemnités de rupture « supra légales » déclarées en bloc 52 servent à calculer le différé spécifique d’indemnisation. Ce différé est calculé selon la formule :
Différé spécifique = Indemnités supra légales ÷ 109,6 (pour 2025)
Le différé est plafonné à 150 jours calendaires (75 jours en cas de licenciement économique).
Différé congés payés
L’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) génère un différé calculé en divisant le montant de l’ICCP par le salaire journalier de référence, plafonné à 30 jours.
Évolutions réglementaires 2025
Nouveautés dans la déclaration DSN
Depuis 2025, l’indemnité transactionnelle doit être déclarée dans deux blocs 52 séparés :
-
Code 022 « Indemnité transactionnelle » : pour le montant total
-
Code 055 « Indemnité transactionnelle exonérée fiscalement » : pour la part exonérée
Modifications du calcul du salaire journalier de référence
Depuis le 1er avril 2025, plusieurs évolutions impactent le calcul :
-
Mensualisation sur 30 jours fixes quel que soit le mois
-
Plafonnement des jours non travaillés à 70% des jours travaillés (au lieu de 75%)
-
Évolution des seuils d’âge : la période de référence de 36 mois s’applique désormais à partir de 55 ans (au lieu de 53 ans)
Bonnes pratiques déclaratives
Règles de non-cumul
Principe fondamental : les primes déclarées en bloc 52 ne doivent jamais être incluses dans le bloc 51 de type 002 « Salaire brut servant aux calculs des droits de l’Assurance chômage ».
Exception notable
L’indemnité de congés payés versée en cours de contrat constitue la seule exception : elle doit être déclarée à la fois :
- En bloc 52 avec le code 046 « Indemnité de congés payés »
-
En bloc 51 de type 002 « Salaire brut servant aux calculs des droits de l’Assurance chômage »
Datation et périodes de rattachement
La datation du bloc 51 de type 002 doit refléter la période d’activité, contrairement au bloc 51 de type 001 qui porte sur la période de paie. Si une prime de septembre est payée en décembre, elle sera valorisée en date de septembre pour le type 002, mais en décembre pour le type 001.
Contrôles et cohérence
Contrôles automatisés
La DSN intègre de nombreux contrôles pour assurer la cohérence entre le motif de départ (bloc 62) et les indemnités versées (bloc 52). Ces contrôles permettent d’éviter les erreurs déclaratives et de sécuriser le traitement par France Travail.
Fiabilisation du montant net social
Dans le cadre de la fiabilisation du montant net social, la déclaration séparée de l’indemnité transactionnelle en deux blocs distincts permet une meilleure traçabilité fiscale et sociale.
La détermination du salaire de référence pour le calcul de l’ARE repose sur une connaissance précise des règles déclaratives DSN et des spécificités de chaque type de rémunération. Les évolutions récentes de la réglementation, notamment les modifications de 2025, renforcent l’importance d’une déclaration rigoureuse pour garantir l’exactitude des droits des demandeurs d’emploi et éviter les différés d’indemnisation non justifiés.